Or, cette reconnaissance du modèle Bourguignon et de la qualité de ses vins est aujourd’hui confrontée à des défis majeurs : défis environnementaux (changement climatique, plan Écophyto, lutte contre les ravageurs), défis économiques (concurrence d’autres modèles viti-vinicoles, viabilité et rentabilité des entreprises de la filière), défis technologiques (viticulture de précision, pratiques oenologiques, virage numérique).
Face à ces défis, il est vital de comprendre les mutations majeures déjà à l’oeuvre ou qui vont se produire dans un avenir proche pour le modèle viti-vinicole bourguignon. Il faut également remettre en perspective ce qui fait la force de ce modèle et comment il peut évoluer pour consolider sa position d’excellence à l’échelle mondiale. Il y a donc une nécessité absolue de comprendre et d’accompagner les choix stratégiques des différents acteurs à tous les stades, de l’élaboration à la commercialisation, du sol et de la vigne jusqu’à la bouteille sur table, bien au-delà de la seule approche technicienne, qui ne s’applique qu’au produit final où à l’une de ses étapes d’élaboration.
Ce projet concerne très concrètement la construction de la qualité des vins de Bourgogne au travers de programmes transdisciplinaires impliquant non seulement les sciences expérimentales (physiologie, microbiologie, climatologie, physico-chimie, analyses sensorielles…) mais également les Sciences Humaines et Sociales (communication, histoire, sociologie, linguistique, économie…). Il vise également à créer entre chercheurs et professionnels un nouvel espace d’action et d’engagement commun, à la fois dans une logique de transfert de connaissances et d’applications, et d’identification des besoins prioritaires, en lien avec toutes les dimensions de la filière viti-vinicole bourguignonne.
Secteur scientifique : Vigne et Vin
Responsables du projet : Régis GOUGEON et Jean-Jacques BOUTAUD
Laboratoires de l’uB porteur et partenaires
Agroécologie / Biogéosciences / CSGA / PAM / CIMEOS / TIL / INSERM U866 « Lipides, Nutrition, Cancers » / MSH / ARTeHIS / CGC / ICB / CREDIMI.
Partenaires financiers
Fonds PARI et Fonds européen de développement régional (FEDER)
Vigne et vin : la construction de la qualité
Actuellement, le champ de valorisation des coproduits générés par la vinification reste limité à la distillation et le compostage. L’intérêt du projet Valvigne est de proposer d’autres alternatives pour la création de coproduits à haute valeur ajoutée. Une autre originalité de ce projet réside dans une logique d’économie circulaire dans la filière viti-vinicole. Certains composés (pectines, peptides, polyphénols) présents dans ces coproduits du vin sont aujourd’hui inexploités. Il est proposé de mettre en oeuvre des procédés d’extraction respectueux de l’environnement et sélectifs : ainsi l’équipe PCAV développera l’extraction physique et l’équipe FBI l’extraction enzymatique. Les extraits de coproduits du vin (peptides, polyphénols, pectines) pourront par la suite avoir plusieurs applications oenologiques (réduction des sulfites) (PCAV) et viticoles (Phytostimulants) (Agroécologie). Coût total programmé : 66 265,00 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2020Descriptif du projet
Montant UE programmé : 36 445,75
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
VALVIGNE : Valorisation de coproduits vinicoles : extractions et applications innovantes (stabilité oxydative du vin et biocontrôle de la vigne)
Financement d’allocations de thèse d’une durée de 36 mois afin que les doctorants puissent mener à bien leur projet de recherche en parallèle de leur projet d’entreprise, afin de valoriser l’innovation issue de la recherche publique. Coût total programmé : 851 138,00 Début prévisionnel d’opération : 01/10/2015Descriptif projet
Montant UE programmé : 417 905,00
Fin prévisionnelle d’opération : 30/06/2020
Thèses Jeunes Chercheurs Entrepreneurs
Une part importante de la recherche mondiale en optique intégrée vise au développement de nouvelles sources large-bande et à haute cohérence, appelées peignes de fréquences. Ces dispositifs miniatures et peu gourmands en énergie sont destinés à être embarqués dans des systèmes de diagnostiques compacts permettant à son utilisateur l’analyse d’espèces chimiques, de cellules vivantes, ou encore de procéder à des mesures de distances ultra-précises. La génération de ces peignes de fréquences exploite les propriétés de l’optique non-linéaire au sein de résonateurs en anneau dans lesquels la lumière va y recirculer à l’infini. La recherche sur les peignes de fréquences s’est fortement accélérée depuis une dizaine d’années grâce à la découverte d’une solution temporelle ultra-robuste, le soliton de cavité, capable de recirculer au sein du résonateur sur des temps longs et y soutenir un peigne de fréquences. Le projet Solstice propose plusieurs avancées scientifiques basées sur l’émergence de structures temporelles ultra-courtes dans des résonateurs non-linéaires via l’exploitation des modes de polarisation. La miniaturisation et l’intégration de ces structures sur une puce optique permettra la génération de peignes de fréquences, et leur application, à des échelles jusque-là inaccessibles. Coût total programmé : 245 900,94 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2020Descriptif du projet
Montant UE programmé : 134 169,95
Fin prévisionnelle d’opération : 30/09/2022
Solstice – Solitons vectoriels et résonateurs en dispersion normale
Les déterminants de l’alimentation sont multiples, incluant des facteurs environnementaux (socio-culturel, économique), physiologiques (perception sensorielle, faim et satiété, stade de développement, statut métabolique, pathologie) et psychologiques (culture, représentation, attente). Ces facteurs participent aux choix et à l’acte alimentaires, et par là même influencent les conséquences de l’alimentation sur notre bien-être. Mieux comprendre et prendre en compte ces déterminants est un enjeu scientifique pour les connaissances des relations entre alimentation, bien-être et pathologies, ainsi qu’un prérequis à l’édition de recommandations à la fois pour la sphère socio-économique et pour les politiques publiques.
Ce projet a pour ambition une meilleure compréhension des mécanismes physico-chimiques, biologiques, comportementaux et psychologiques qui sous-tendent la perception sensorielle, la prise alimentaire et le choix des aliments tout au long de la vie : périodes précoces et tardives de la vie de l’individu sain mais aussi en conditions pathologiques. L’alimentation sera considérée dans ses acceptions de produits, de régimes et d’actes alimentaires. Les leviers ne se limiteront donc pas au développement de produits ; ils incluront non seulement l’amélioration des politiques publiques et les recommandations nutritionnelles, mais également la prise en considération du plaisir à manger.
Secteur scientifique : Aliment et Environnement
Responsable du projet : Luc PENICAUD
Laboratoires de l’uB porteur et partenaires
CSGA (UMR 6265) / PAM / Centre INSERM / Plate-forme CHEMOSENS / Plateau technique animalerie
Partenaires financiers
Fonds PARI et Fonds européen de développement régional (FEDER)
Sensorialités, comportements alimentaires, bien-être, santé
L’objet du projet collaboratif global ROLLKERS est le développement d’un Équipement de Déplacement Personnel (EDP) innovant, se distinguant des équipements connus à ce jour par sa capacité à enjamber, franchir les trottoirs et les seuils, ainsi qu’à prendre les transports en commun. Coût total programmé : 256 050,00 Début prévisionnel d’opération : 01/10/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 121 000,00
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
ROLLKERS RMM
Porteur : université de Bourgogne, Mission Culture Scientifique
Partenaires :
- Université de Franche-Comté
- Science action Normandie
- Aix Marseille Université
- OCIM, université de Bourgogne
L’Experimentarium a été lauréat en 2015 des programmes d’investissement d’avenir (PIA) pour l’égalité des chances. Ainsi soutenu par le CGI et l’ANRU**, le Réseau des Experimentarium a vu le jour.
Il regroupe quatre régions : Bourgogne, Franche-Comté, Normandie et Provence Alpes Côte d’Azur, en partenariat avec la Lorraine et la Guyane.
Le Réseau des Experimentarium a pour but d’essaimer « l’art de la rencontre » développé par l’Experimentarium® en Bourgogne depuis 2001. Dans toutes les régions, des chercheurs sont formés à partager leur activité dans le cadre d’ateliers-rencontre de 20 minutes. Une démarche d’innovation en médiation scientifique est mise en place par le réseau. L’OCIM (Office de Coopération et d’Information Muséales) assure une observation de ce développement et propose des formations ouvertes aux médiateurs scientifiques de tous horizons.
Tous les ans, le réseau se regroupe pour un « festival des Experimentarium » dans une ville de France. Venez en découvrir plus sur le site : http://www.experimentarium.fr/
**: CGI : Commissariat Général à l’Investissement; ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
Réseau des experimentarium
Ce projet de recherche s’intéresse au rôle d’un régulateur de la méthylation de l’ADN, dont l’activité est normalement restreinte au tissu neuronal, dans la pathogenèse d’un sous-type de lymphome B malin agressif, les lymphomes à cellules du manteau (LCM). Les LCM représentent 5% des lymphomes B malin non-Hodgkiniens. L’identification de mutations causales de la cancérisation dans les LCM est restée élusive, rendant difficile le développement de thérapies rationalisées. En revanche, des perturbations épigénétiques globales, en particulier de la méthylation de l’ADN sont décrites. Même si les mécanismes ne sont pas encore connus, ceci indique un rôle clef de la méthylation de l’ADN dans le développement et/ou progression des LCM. Suite à une étude protéomique, notre équipe a révélé la surexpression anormale d’un facteur de régulation de la méthylation de l’ADN dans les LCM et dans les lymphomes B diffuse à grandes cellules. Fait remarquable, cette surexpression n’est pas observée dans les lymphomes indolents ni dans les cellules lymphoïdes B normales suggérant un rôle particulier de ce facteur dans les lymphomes agressifs. Le projet REHETLYM propose donc d’étudier l’impact pathogène de l’expression aberrante de ce facteur dans les LCM, avec comme objectif 1/ d’identifier de nouveaux mécanismes physiopathologiques d’intérêt thérapeutique dans les LCM 2/ d’évaluer l’intérêt diagnostique et pronostique de ce facteur chez les patients atteints de LCM. Coût total programmé : 238 640,00 Début prévisionnel d’opération : 01/01/2020Descriptif du projet
Montant UE programmé : 108 640,00
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
ReHETLym : Reprogrammation aberrante de l’hétérochromatine dans les cancers lymphoïdes ; rôle de la méthylation de l’ADN
A travers ses différents laboratoires, l’Université de Bourgogne est impliquée dans de nombreux projets de recherche européens et internationaux. L’Agence Nationale de la Recherche a pour mission la mise en œuvre du financement de la recherche sur projets en France.
Les fonds provenant de l’Agence Nationale de la Recherche ont été mobilisés pour financer des projets de recherche couvrant l’ensemble des champs disciplinaires de l’Université.
Depuis la création de l’ANR en 2005, l’Université de Bourgogne a participé à une centaine de projets ANR pour un montant de subvention d’environ 15 millions d’euros.
Pour la dernière campagne en cours, l’UB a obtenu 11 projets pour une somme total de 1.8 millions d’euros.
Projets ANR
L’équipe Valmis de l’UMR PAM est un laboratoire de Microbiologie qui étudie au niveau moléculaire, cellulaire et physiologique la réponse au stress des micro-organismes (levures et bactéries) en lien avec leurs environnements et les phénomènes d’interaction entre cellules. Les recherches débouchent sur la compréhension des mécanismes mis en jeu mais également sur des collaborations industrielles dans les domaines du vin et de l’agroalimentaire au sens large. L’équipe Valmis mettra à disposition son savoir-faire technique et scientifique pour formuler de manière innovante de nouvelles souches appartenant à la société Nexidia, afin d’étudier les effets immunomodulateurs des bactéries probiotiques jusqu’à l’identification et la caractérisation des principes actifs (véhiculés par les vésicules extracellulaires). Un autre objectif majeur du projet est de déterminer le rôle des vésicules membranaires, libérées naturellement par les bactéries probiotiques, dans l’interaction moléculaire avec les cellules de l’hôte se traduisant par une immunomodulation et un effet santé. Le projet qu’il est envisagé de développer en collaboration avec la société Nexidia permettra de savoir si une souche unique peut apporter à la fois de bonnes propriétés anti-pathogènes et immunomodulatrices ou s’il est nécessaire de formuler ces souches sous forme d’une combinaison de plusieurs souches afin d’allier leurs effets bénéfiques. Coût total programmé : 208 034,09 Début prévisionnel d’opération : 01/10/2020Descriptif du projet
Montant UE programmé : 104 017,05
Fin prévisionnelle d’opération : 30/09/2022
Projet NAF – Nexidia Animal Feed : Nouvelle génération de probiotiques pour l’alimentation animale
Les dispositifs sociotechniques ont modifié les relations sociales, le rapport à l’altérité et au temps mais également l’écosystème médiatique. On observe l’émergence de nouvelles formes de communication interpersonnelle et communautaire, de nouveaux types de reliance et in fine de nouveaux champs d’expression et de discussion utilisant toute la force de ces canaux de communication, à la fois participatif et réticulaire. La multiplicité des acteurs, la rapidité de diffusion des messages, leur impact potentiel sur les marques/produits représentent un risque important pour les entreprises qui ne disposeraient pas d’analyses des informations transitant sur les réseaux et donc d’éléments d’aide à la décision pour adapter leur politique commerciale et leur stratégie de communication. Dans ce contexte mouvant, les outils informatiques, dont disposent les entreprises, sont de véritables « boites noires » et n’intègrent pas les spécificités et le contexte métier. Le projet créera un observatoire en temps réels des tendances et des signaux faibles circulant dans les discours du domaine alimentaire sur Twitter, véritable chambre de résonance favorisant l’instantanéité, l’immédiateté et la rapidité de propagation de l’information. Il s’agira de réaliser une plateforme numérique associant big data, outils d’analyse en temps réels et intelligence artificielle pour le traitement des données massives. Coût total programmé : 515 730,00 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 255 365,00
Fin prévisionnelle d’opération : 16/03/2023
Projet COCKTAIL
Descriptif du projet
Les plateformes * et les plateaux techniques ** sont des composantes essentielles de la stratégie scientifique de l’université de Bourgogne et de ses partenaires du Grand Campus.
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, l’activité des équipes de recherche nécessite des équipements extrêmement performants. L’organisation de ces plateformes, leur maintien au plus haut niveau technologique, leur labellisation s’inscrivant dans une démarche « qualité », leur visibilité, sont des critères à développer pour augmenter l’attractivité des partenaires du Grand Campus vis-à-vis du milieu industriel.
La mise en place fin 2013 du Comité d’Orientation Stratégique (COS) démontre la volonté de l’uB et de ses partenaires d’optimiser le fonctionnement de ces plateformes, leur portage financier et leur modèle économique. Le COS « Plateformes », composé de responsables des tutelles et établissements du Grand Campus, de responsables de plateformes et de directeurs d’unité des 6 domaines scientifiques, se réunit environ tous les 2 mois.
Le COS « Plateformes » a élaboré un plan stratégique pluriannuel de développement et d’investissement commun. Il a procédé au recensement des besoins en équipements pour la période 2014-2018 sur la base de critères objectifs : degré de mutualisation inter-plateformes et inter- laboratoires, potentiel de valorisation, lien avec un ou plusieurs projets PARI2, valeur stratégique de l’investissement pour les partenaires du Grand Campus (lien avec un PIA, projet ANR, FUI, …). Pour accompagner ces objectifs, le COS a établi un socle de règles de fonctionnement et a élaboré une charte commune à toutes les plateformes. Une Assemblée Générale des plateformes à laquelle sont conviés les représentants des laboratoires, des plateformes et plateaux techniques, est organisée chaque année afin de rendre compte des activités du COS.
Contact : Support recherche
* La Plate-forme est le regroupement d’équipements, de moyens humains et de compétences développant et offrant à une communauté d’utilisateurs internes et externes au Grand Campus des ressources technologiques de haut niveau.
** Le Plateau technique s’identifie à un outil spécifique d’une équipe ou d’un laboratoire.
Programme transversal Plateformes du PARI
Les piles à combustible sont des systèmes électrochimiques qui convertissent l’énergie d’un combustible en électricité. Dans le cas des piles fonctionnant à l’hydrogène, la réaction s’effectue avec l’oxygène de l’air et le produit formé est simplement l’eau, H2O. Le projet PILOT-Hy vise à élaborer des cellules de pile à combustible PCFC (Protonic Ceramic Fuel Cell) en vue de leur intégration dans un empilement au sein duquel des alliages métalliques à plusieurs éléments (appelés alliages à haute entropie) pourront être testés comme interconnecteurs. Les cellules PCFC seront fabriquées par frittage avec une étape intermédiaire de dépôt par pulvérisation cathodique pour optimiser les propriétés interfaciales. Elles seront testées du point de vue de leur performance électrique sur un banc Probostat, puis sur le dispositif short stack kit constitué d’empilement cellules-interconnecteur au laboratoire ICB. Les matériaux constituant l’électrolyte seront élaborés à l’ICB par synthèse hydrothermale, leur granularité sera adaptée aux objectifs de microstructure des cellules. Les dépôts d’électrolyte seront réalisés en collaboration avec le laboratoire FEMTO-ST par pulvérisation magnétron à partir de cibles appropriées sur les électrodes. Ce projet sur l’utilisation de l’hydrogène comme vecteur énergétique s’inscrit dans les recherches liées au projet ENRGHy de la Région Bourgogne Franche-Comté labellisée Territoire Hydrogène. Coût total programmé : 215 851,75 Début prévisionnel d’opération : 01/10/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 98 698,04
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
PILOT-Hy : oPtimisation de cellule de pILe à cOmbustible foncTionnant à l’Hydrogène
L’objectif est de répondre à un besoin de maîtriser toute la chaine de la conception depuis la chimie des agents d’imagerie, l’instrumentation physique et le traitement d’images, jusqu’à la conduite d’essais clinique. La combinaison entre imagerie à visée diagnostique et thérapeutique permettra également un meilleur service médical rendu. Les aires thérapeutiques concernées sont notamment le cancer et les maladies cardiovasculaires.
Les principaux enjeux de ce thème :
- Diminuer le taux d’attrition du développement de nouveaux médicaments
- Identifier des sous-populations de patients répondant au traitement par le diagnostic
- Faire face aux coûts importants et au manque de standardisation des essais cliniques de phase précoce.
Le projet mobilise une forte transdisciplinarité et intègre une composante forte de recherche translationnelle pour évaluer de nouvelles thérapeutiques au plus tôt chez l’animal et d’en assurer le passage chez l’homme en recherche clinique exploratoire.
Axes du projet :
1. Qualification des molécules développées antérieurement pour le passage clinique
2. Développement d’agents théranostiques
3. Actions de valorisation et de services aux laboratoires et aux entreprises
Secteur scientifique : Santé et Ingénierie Moléculaire
Responsable du projet : Pr Frank DENAT
Laboratoires de l’uB porteur et partenaires
Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne / Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne / Laboratoire d’Electronique, Informatique et Image / Laboratoire Lipides, Nutrition, Cancer.
Partenaires financiers
Fonds PARI et Fonds européen de développement régional (FEDER)
Pharmacoimagerie et agents theranostiques (3MIM)
Différents stress sont responsables de l’instabilité du rendement du pois : les maladies majeures, le gel, la sécheresse et les fortes températures au moment de la floraison et du remplissage des grains, ou encore les attaques d’insectes. PeaMUST mettra à profit les technologies de séquençage, génotypage et phénotypage à haut débit pour aborder le défi de l’augmentation de la tolérance aux stress multiples.
Porteur/Partenaires :
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) – UMR en génétique et écophysiologie des légumineuses (INRA-LEG) – Paris, Versailles (Thiverval-Grignon, Guyancourt), Le Pecq, Evry, Orsay, Rodez, Dijon, Toulouse (Castanet-Tolosan), Montpellier, Rennes (Le Rheu), Grenoble, Angers (Beaucouzé), Lille (Mons-en-Pévèle), Lestrem, Clermont-Ferrand (Riom, Chappes), Amiens, Péronne, Froissy.
PeaMUST : Adaptation Multi-STress et Régulations biologiques pour l’amélioration du rendement et de la stabilité du pois protéagineux
La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age est la 1ère cause de handicap visuel chez les personnes âgées de plus de 50 ans dans les pays développés. Le risque de survenue de la maladie augmente avec l’âge pour dépasser 25% de la population après 75 ans. Cette maladie atteint la macula, zone centrale de la rétine, permettant la vision fine ou centrale. Il existe de nombreuses formes dont la forme exsudative où l’un des traitements consiste à injecter dans l’œil un anticorps anti-VEGF dans le but d’inhiber la formation de néovaisseaux. Ces traitements ne semblent pas satisfaisant à long terme. Il semble que des traitements préventifs et/ou de bonnes habitudes alimentaires puissent réduire le risque d’évolution vers une forme avancée de la maladie. Ceux-ci ont démontré leur efficacité dans la prévention et seront adaptés à ceux qui ont un œil altéré mais qui conservent leur deuxième œil. Dans ce contexte scientifique, nous avons initié une recherche concernant l’évaluation de l’impact d’anti-oxydants issus de la vigne et du vin sur les principales voies de signalisation conduisant au développement de la DMLA. Ce projet déterminera si des extraits enrichis en polyphénols issus de la vigne et du vin permettent de diminuer la néovascularisation chez des cellules rétiniennes pathologiques et de préserver des cellules saines. Ces résultats seront confortés in vivo chez des animaux dans lesquels aura été induite une néovascularisation de l’œil permettant de mimer la DMLA. Coût total programmé : 129 650,00 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2020Descriptif du projet
Montant UE programmé : 71 150,00
Fin prévisionnelle d’opération : 30/09/2022
P2VDMLA – Polyphénols de la Vigne et du Vin et Dégénérescence Maculaire liée à l’Age
La recherche actuelle en optique guidée vise à créer des systèmes facilement reconfigurables («smart systems»), plus compacts, et moins gourmands en énergie. Cela permet notamment de viser de nouvelles applications dans les domaines des télécoms et des capteurs, liées par exemple à l’analyse d’espèces chimiques ou aux systèmes embarqués/distribués. Il est d’autant plus crucial de développer ce type de systèmes optiques puisqu’ils sont essentiels pour le déploiement pratique et à grande échelle des nouvelles technologies (ex : objets connectés, réseaux sociaux, analyses d’espèces chimiques, etc…) qui sont très demandeuses en terme de points d’accès au réseau global et en flux de données à échanger. Dans ce contexte, le projet Optiflex, porté par le laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, propose plusieurs avancées technologiques basées sur des solutions tout-optiques pour le traitement du signal et l’analyse de polluants chimiques. Plus précisément, nous développerons des solutions pour le stockage et le partage de données optiques dans le réseau coeur à travers la conception de buffers optiques couplés à une nouvelle technique de compression temporelle. Nous développerons également un système de spectroscopie à continuum sur puce optique pour la détection et l’analyse d’espèces chimiques et nous étudierons une nouvelle stratégie de production de supercontinua basée sur l’excitation d’une population électronique hors-équilibre au sein d’une antenne nanométrique. Coût total programmé : 803 279,57 Début prévisionnel d’opération : 01/01/2020Descriptif du projet
Montant UE programmé : 441 803,76
Fin prévisionnelle d’opération : 01/01/2023
Optiflex : Fonctions optiques pour la gestion de flux de données
Résumé de l’opération
Le changement le plus récent et probablement le plus important dans le domaine de l’oncologie ces dernières années est le développement de l’immuno-oncologie, et plus particulièrement des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. L’utilisation des anticorps monoclonaux ciblant PD-1 et PD-L1 a considérablement modifié la façon d’appréhender la thérapie anticancéreuse. En effet, ces médicaments sont efficaces sur un large éventail de cancers, ont peu d’effets secondaires et induisent des réponses durables chez les patients métastatiques. Néanmoins, dans la plupart des cancers, l’efficacité est limitée à environ un quart des patients traités.
Nous proposons de déterminer l’association la plus optimale d’un agent chimiothérapeutique avec des inhibiteurs ciblant PD1/PD-L1 ainsi que la découverte de nouveaux marqueurs de réponse à l’immunothérapie. Grace à nos partenaires cliniciens nous avons l’accès à des cohortes cliniquement bien annotées de patients avec des échantillons biologiques de sang et de matériel tumoral de haute qualité disponibles avant le traitement, pendant le traitement et lors de la rechute.
Les principaux objectifs de ce projet de recherche transactionnelle sont :
- Quels patients sont plus aptes à répondre aux inhibiteurs de PD-1 / PD-L1 ?
- Comment combiner cette immunothérapie avec d’autres thérapies ?
- L’immunosuppression est-elle une cible de l’immunothérapie ?
- Comment développer de nouvelles immunothérapies ciblées ?
Coût total programmé : 412 000,00
Montant UE programmé : 185 400,00
Début prévisionnel d’opération : 25/09/2018
Fin prévisionnelle d’opération : 24/09/2021

OPTICANCER : Optimisation des procédures d’immunothérapie dans le cancer
En Région Bourgogne, la réponse à ce défi mobilise d’ores et déjà, de façon coordonnée à travers le projet régional Nano2bio, l’Université de Bourgogne, l’INSERM, le CHU Dijon, le CGFL, des entreprises en Bourgogne-Franche-Comté et la SATT Grand-Est. Nano2bio établit un lien fort entre recherches fondamentales en nanotechnologies/ nanomatériaux et les utilisateurs finaux potentiels. Cette configuration est peu fréquente en France et même au niveau international. Le projet vise à intégrer les composantes d’une recherche pluridisciplinaire (biologie-médecine, chimie, physique) : aspects théoriques, aspects expérimentaux et ingénierie d’intégration de différentes technologies. L’objectif est de créer des combinaisons originales pour garantir à la Région un haut niveau de compétitivité dans ce domaine sur la scène internationale. Cette compétitivité est la condition pour anticiper les dépôts de brevets, donc pour espérer traduire les résultats des activités de recherche en opportunités industrielles.
Pour la Région Bourgogne, les retombées visées sont :
• Progrès de la recherche médicale à l’aide des nanotechnologies : études cliniques dont les patients du CGFL bénéficieront en primeur.
• Collaborations avec la PME bourguignonne NVH Medicinal.
• Prestations pour des entreprises : les montants versés sont investis dans la recherche en Bourgogne (emplois de thésards, post-docs ou ingénieurs)
• Développement de deux nouveaux instruments scientifiques et, en lien avec la SATT Grand Est, recherches de partenariats industriels pour les exploiter.
• Développement de l’activité « Nanotoxicité » notamment par la recherche de scénarios de transferts.
Positionnement du projet
Le consortium Nano2bio dispose d’avantages compétitifs dans les domaines suivants :
- Combinaison de la spectroscopie optique au microscope à force atomique à vitesse vidéo afin d’augmenter la résolution spatiale à la surface de cellules. Un exemple d’application est l’observation du mécanisme d’infection virale à l’échelle d’une cellule.
- Combinaison de simulations de protéines à l’aide de supercalculateurs, de la microfluidique et de techniques biophotoniques de reconnaissance spectrale de protéines en milieu physiologique dans des conditions extrêmement diluées ou à la surface de cellules. Cette technique est utile au diagnostic précoce de pathologies tels que le cancer, la maladie d’Alzheimer ou les maladies cardio-vasculaires.
- Développement de nanoparticules pour la vectorisation de médicaments pour réduire les effets secondaires des thérapies, pour la régénération tissulaire et la cicatrisation, ainsi que pour le diagnostic par imagerie médicale multimodale (IRM, Imagerie nucléaire).
- Nouveaux biotests et nouveaux modèles in vivo adaptés à l’étude de la toxicité des nanoparticules. Dans ce cadre, développement à Dijon de la plateforme NanoCare (SATT Grand-Est et uB) dont l’objectif est de devenir un leader français en termes d’évaluation des risques liés aux nanoparticules (tests in vitro, études de biodistribution, etc.).
Secteur Scientifique : Photonique et matériaux avancés
Coordinateur scientifique : Prof. Alain DEREUX
Coordinateur adjoint : Johanna CHLUBA
Laboratoires / équipes internes porteurs :
ICB OSNC (Optique Submicronique et NanoCapteurs)
INSERM U866 Equipe 3 : Protéines de stress : mort cellulaire, différenciation cellulaire et propriétés tumorogéniques
Laboratoires / équipes internes partenaires :
ICB MANAPI (Matériaux Nanostructurés et phénomènes aux interfaces)
ICB PHAP (Physique Appliquée aux Protéines)
ICB SIOM (Surfaces et Interfaces d’Oxydes Métalliques)
ICB DTAI (Département Technique d’Analyse et d’Instrumentation) : Plateformes ARCEN-CARNOT & PICASSO
CGFL Radiothérapie : Prof. Ph. Maingon & Dr. Méd. G. Créhange
INSERM U866 Equipe 1 : Chimiothérapie et réponse immunitaire anti-tumorale
INSERM U866 Equipe 7 : Nutox : détection et métabolisme des lipides et des contaminants alimentaires dans la sphère orodigestive : effets sur la santé et le comportement alimentaire
Welience Plateforme NanoCare, DERTECH
Nano2Bio / Projet intégré d’applications des nanotechnologies à la biologie et à la médecine
Les maladies neurodégénératives (MD), telles que les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, touchent 1 300 000 personnes en France sans aucune thérapie efficace. Le projet vise à identifier au niveau moléculaire les causes des MD et à rechercher des solutions thérapeutiques innovantes par une approche pluridisciplinaire en nanosciences. Les dysfonctions cellulaires et les mécanismes de fibrillation (alpha-synucléine, tau, amyloides) présents dans les MD seront caractérisés à l’échelle nanoscopique par microscopies à force atomique couplées au Raman et aux micro-ondes, par spectrocopie sur molécule unique, par imagerie utilisant des nanoparticules multifonctionnelles originales (SPIONs), et par simulations numériques à haute performance. Les voies thérapeutiques nouvelles explorées seront basées sur la fonctionnalisation de nanoparticules hybrides originales. Le projet implique 4 équipes de recherche (17 chercheurs et enseignant-chercheur) du département Nanosciences du Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne en collaboration avec des partenaires régionaux, nationaux, et internationaux (USA, Canada, Japon, Suisse, Autriche, Norvège et Estonie) et des partenaires privés développant une recherche au-delà de l’état de l’art. Coût total programmé : 159 676,00 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 63 870,00
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
NANO-NEURO-MED : Caractérisation à l’échelle NANOscopique des maladies NEURO dégénératives et solutions thérapeutiques issues des nanosciences : applications en MEDecine
Le projet MULTIMOD cherche à développer et valider de nouveaux agents d’imagerie multimodale et théranostiques pour répondre à des besoins cliniques précis : diagnostic et thérapie de cancers, diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou encore de l’athérosclérose. Fort de compétences et savoir-faire acquis via de nombreux projets (3MIM, programme PARI, Equipex IMAPPI, ANR, H2020), l’ICMUB est devenu un acteur majeur dans le domaine de l’imagerie moléculaire. Son expertise est indispensable au développement de ces nouveaux agents alliant différentes techniques d’imagerie (optique, nucléaire, IRM, Cherenkov). Avec l’aide de ses partenaires académiques et privés, dans un contexte local extrêmement favorable (GIE Pharmimage et GIS « Pharmacoimagerie »), les techniques indispensables aux étapes complexes de telles études (synthèse, radiochimie, études in vitro, imagerie in vivo) sont regroupées afin de mener à bien ce projet ambitieux. Les étapes consisteront à : Le projet MULTIMOD aura un fort impact économique et sociétal, en confortant le leadership du site BFC dans le domaine de l’imagerie moléculaire, en permettant de développer des opportunités de collaboration/partenariat, et, in fine, en apportant de nouvelles solutions en médecine personnalisée. Coût total programmé : 297 400,00 Début prévisionnel d’opération : 01/10/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 158 775,31
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
MULTIMOD – Conception et évaluation in vivo de nouveaux agents d’imagerie multimodaux
Le projet MONTCEAU entend étudier et mettre au point la fabrication d’un disque graphite à 312 chambres «net shape» via la technologie de frittage rapide SPS (Spark Plasma Sintering) en vue de l’implanter dans le dispositif Hydrogen 2.0, technologie innovante développée et brevetée permettant de produire de manière industrielle (grands volumes) et économique (productivité, faible usure des outillages, pas de reprise d’usinage, faibles coûts énergétiques) de l’hydrogène à partir d’eau salée. Le projet doit permettre de produire un démonstrateur échelle 1 (passage d’un TRL de 4 à 7) via le soutien des compétences du laboratoire ICB (Centre EXCALIBURE), puis d’envisager une mise en production grâce une étude d’industrialisation menée par SINTERMAT (passage d’un TRL de 7 à 9). Les modules Hydrogen 2.0 fabriqués par la société NATUREGIE proposeront une offre innovante de production décentralisée d’hydrogène, hors infrastructure réseau, réellement propre et efficace, et ainsi enfin faire jouer à l’hydrogène un rôle prépondérant dans le mix énergétique. Coût total programmé : 386 200,00 Début prévisionnel d’opération : 01/01/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 190 512,56
Fin prévisionnelle d’opération : 30/12/2022
MONTCEAU – Prototype de groupe électrogène de 30 kVA utilisant la technologie Hydrogen 2.0
Chaque année, plus de 200 000 patients sont traités par radiothérapie en France. Ce traitement locorégional consiste à utiliser des rayonnements ionisants pour stériliser les cellules cancéreuses en les détruisant ou en bloquant leur capacité à se multiplier ou en induisant leur mort. Dans le but d’optimiser la balance bénéfice (contrôle tumoral)/risque (toxicité tissus sains), beaucoup d’efforts ont été faits afin de délivrer un maximum de dose à la tumeur tout en épargnant les tissus sains en introduisant des modalités d’irradiation du patient de plus en plus sophistiquées. Cependant, les effets biologiques de ces nouvelles procédures d’irradiation caractérisées par des doses, volumes, énergies et débits très variés sont largement ignorés. Ce projet, qui s’appuie sur la complémentarité des domaines d’expertise de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire) et de l’IMB (Institut de Mathématiques de Bourgogne), propose d’établir une modélisation multi-échelle de l’efficacité biologique relative pour la prédiction des risques non-cancer après exposition aux rayonnements ionisants. Coût total programmé : 135 289,00 Début prévisionnel d’opération : 01/10/2020Descriptif du projet
En contexte clinique, la dose prescrite est une pondération de la dose absorbée par des facteurs intégrant l’efficacité biologique relative du type de rayonnement (EBR). Dans la pratique clinique, les EBRs sont très importants car utilisés dans le calcul des doses biologiques équivalentes (BED) afin de comparer l’impact de différents protocoles de fractionnement.
Montant UE programmé : 74 389,00
Fin prévisionnelle d’opération : 30/09/2023
MODBIOCAN : Modélisation multi-échelle de l’efficacité biologique relative pour la prédiction des risques non-cancer après exposition aux rayonnements ionisants
METABOLOM : Etude du métabolome des boissons fermentées par approches analytiques et de bioinformatique pour la maîtrise de la qualité du vin et du Kombucha L’acquisition récente à l’UMR PAM, de la spectrométrie de masse à très haute résolution permet de porter un regard analytique sans précédent sur la diversité chimique présente à toutes les étapes d’élaboration des vins. On parle alors d’analyse métabolomique, permettant de cartographier plusieurs dizaines de milliers de petits métabolites. Ces grands jeux de données sont porteurs d’informations moléculaires sur les mécanismes complexes mis en jeu lors des différentes étapes de l’élaboration des vins, depuis la vinification jusqu’à l’élevage et au vieillissement. Ils sont également porteurs d’informations moléculaires relatives à l’adaptabilité des cépages bourguignons au changement climatique à venir. Ainsi, la maîtrise de ces jeux de données ouvre alors de véritables pistes d’innovation pour une meilleure maîtrise de la qualité des vins. Coût total programmé : 438 364,00 Début prévisionnel d’opération : 01/11/2018Descriptif du projet
Le projet collaboratif METABOLOM entre les équipes PCAV, VALMIS et CRC a pour objectif l’intégration de grands jeux de données analytiques afin de construire une cartographie métabolique identitaire des vins de Bourgogne et du Kombucha, une autre boisson fermentée. Outre, les données métabolomiques, l’analyse transcriptomique et la caractérisation de composés d’arômes permettront d’enrichir les bases de données et les modèles prédictifs associés. Pour cela, le projet METABOLOM repose sur l’acquisition d’un lecteur de plaques et d’un équipement de GC-MS, ainsi que le recrutement de deux post-doctorants et d’un doctorant.
Montant UE programmé : 215 764,00
Fin prévisionnelle d’opération : 22/08/2022
METABOLOM
Parmi les enjeux stratégiques, on peut citer la recherche de nouveaux designs, économiquement viables et permettant, soit d’assurer une fonction non atteinte, soit d’alléger une structure, l’étude de moyens d’obtention de composants métalliques ou composites innovants répondant aux contraintes économiques et environnementales d’actualité (économie de matières premières et d’énergie), ainsi que l’obtention de matériaux dont la surface possède des propriétés d’usage spécifiques pour améliorer la durabilité des composants. Il est aussi nécessaire de se positionner par rapport au tissu socio-économique régional dont 50% des emplois industriels concernent les domaines des matériaux, de la métallurgie et des procédés. Le rôle des centres académiques sera de consolider leur approche scientifique pour soutenir l’innovation de ces industries.
Positionnement du projet
D’une manière générale, la mise en œuvre de procédés d’élaboration et de mise en forme de composants de plus en plus complexes, nécessite une maîtrise totale des effets induits par le procédé dans la matière. Elle ne peut donc plus se contenter d’un développement des techniques existantes fondé sur des améliorations ponctuelles issues de simples essais (recherche incrémentale) mais requiert une véritable approche scientifique qui soit à la fois fondamentale et pluridisciplinaire. Cette stratégie doit pouvoir affronter les enjeux comme les nouveaux designs pour assurer des multi-fonctions, l’innovation dans les moyens d’élaboration et l’obtention de composants à durabilité contrôlée. Ces enjeux techniques sont associés à des enjeux sociétaux comme le besoin de sécurisation nécessitant des analyses prédictives (simulations) des procédés et des propriétés d’emploi en conditions réelles. Il s’agira de développer la combinaison d’outils numériques et expérimentaux reposant sur des modèles physico-chimiques décrivant les étapes déterminantes des processus d’élaboration, de fonctionnalisation, d’usinage et d’assemblage. Les couplages, comme celui de la modélisation à l’échelle moléculaire ou atomique des processus aux interfaces à celles du comportement aux échelles plus familières aux ingénieurs, permettront de proposer des outils rigoureux et compétitifs, d’aide à la conception et à la décision.
Secteur Scientifique : Photonique et matériaux avancés
Coordinateur scientifique : Pierre SALLAMAND
Coordinateur adjoint : Roland OLTRA (UB) et Gérard POULACHON (ENSAM Cluny)
Laboratoires / équipes internes porteurs :
Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, LaBoMaP (ENSAM Cluny)
Laboratoires / équipes internes partenaires :
28 ETP, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne
Matériaux et Procédés Avancés
Le syndrome de Cohen (SC) est une maladie génétique rare, due à des mutations dans le gène VPS13B, avec de multiples caractéristiques cliniques dont une répartition anormale des graisses au niveau du tronc, que le projet MASCOT-DM se propose d’étudier. Le centre de génétique de Dijon étant référent dans la prise en charge des patients atteints du SC, il possède une cohorte de 15 patients, tous très impliqués dans les études de recherche. Il dispose également du modèle murin (Knock-Out Vps13b, qui ne possède pas le gène) et des outils et des compétences nécessaires à la réalisation du projet. Le but de MASCOT-DM est de caractériser le phénotype métabolique du modèle murin pour mieux comprendre les désordres métaboliques humains. Ainsi il étudiera de façon fine et mécanistique la mise en place du diabète de type II et de la stéatose hépatique chez la souris. Cette étude sera complétée par des expériences in vitro sur le modèle cellulaire de stéatose hépatique qui seront invalidés pour VPS13B (l’expression de VPS13B sera réprimée pour mimer une cellule de malade). Le projet MASCOT-DM s’articule aussi autour des axes de recherche de 3 autres équipes du centre INSERM 1231. La collaboration entre les 4 équipes, sur des projets communs ou liés entre eux, permettra de faire avancer les connaissances fondamentales sur le SC mais aussi sur les pathologies chroniques fréquentes que sont l’obésité, le diabète de type II et la stéatose hépatique. Coût total programmé : 153 662,26 Début prévisionnel d’opération : 01/10/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 78 990,26
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
MASCOT-DM : Mécanismes cellulAires impliqués dans le Syndrome de COhen et recherche des cibles Thérapeutiques: Diabète et Métabolisme
Porteur/Partenaires :
Fondation de coopération scientifique Bourgogne Franche-Comté / UMR 866 INSERM/uB – Dijon, UMR645 INSERM/UFC/EFS – Besançon, CGSA CNRS/INRA/uB UMR6265/1324 – Dijon, LEG CNRS/UMR5118/uB – Dijon, EA4267 UFC – Besançon, CIMEOS EA4177 uB – Dijon, UMR1009 INSERM/U Paris XI/Institut Gustave Roussy – Villejuif, UMR710 INSERM/U Montpellier/EPHE – Montpellier, EA3181 UFC – Besançon, National Platform Quality of Life and Cancer – Nancy/Marseille, FFCD – Dijon,CIC-CIE 01 and CIC-P803 – Dijon, CIC-CBT506 and CIC-CIT808 – Besançon, CRB Ferdinand Cabanne – Dijon, BioProtein Technologies – Jouy-en-Josas, Nexidia – Dijon, Amylgen – Dijon
Directeur : Laurent Lagrost
L’action « Laboratoires d’Excellence »vise à doter les laboratoires à visibilité internationale sélectionnés de moyens significatifs leur permettant de faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs et enseignants chercheurs de renommée internationale et de construire une politique intégrée de recherche, de formation et de valorisation de haut niveau, ainsi qu’une politique de large diffusion des connaissances.
Partenaires financiers :
Fonds PARI et Fonds européen de développement régional (FEDER)
Labex LIPSTIC – Lipoprotéines et santé : prévention et traitement des maladies inflammatoires non vasculaires et du cancer
Cette miniaturisation permettra aux technologies d’intégrer par exemple des capteurs connectés entre eux et ouverts sur le monde extérieur, des ordinateurs, des logiciels, etc., afin de concevoir des systèmes dit « intelligents » qui s’adaptent et anticipent pour mieux répondre à l’utilisation qui en est faite.
Porteur/Partenaires :
Fondation de coopération scientifique Bourgogne Franche-Comté /Franche Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et Technologies / FEMTO-ST, Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne – ICB, Laboratoire de Nanotechnologie et d’Instrumentation Optique (LNIO), Université de technologie de Troyes (UTT) Coordinateur : Michel de LABACHELERIE www.labex-action.fr L’action « Laboratoires d’Excellence »vise à doter les laboratoires à visibilité internationale sélectionnés de moyens significatifs leur permettant de faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs et enseignants chercheurs de renommée internationale et de construire une politique intégrée de recherche, de formation et de valorisation de haut niveau, ainsi qu’une politique de large diffusion des connaissances.Labex ACTION – Systèmes intelligents intégrés au cœur de la matière
Parmi les enjeux de la recherche contemporaine en physique, beaucoup font appel à des outils mathématiques puissants et performants, donnant lieu à un haut niveau de sophistication et de spécialisation. Parmi ces outils mathématiques, le projet ISA se focalise sur trois techniques précises fortement interconnectées : l’intégrabilité, la théorie de la diffusion (« scattering »), et les méthodes spectrales. Ces méthodes transversales sont utilisées dans deux contextes physiques distincts, mais complémentaires d’un point de vue méthodologique. Le second contexte porte sur les composants optiques intégrés développés en utilisant des nano-matériaux. Il donne lieu à des applications technologiques dans le cadre d’une collaboration IMB/ICB visant le développement de sources optiques et de capteurs ultrasensibles, notamment pour le diagnostic médical. L’approche interdisciplinaire qui est adoptée combine l’étude théorique (IMB) avec les expériences de laboratoire (ICB), pour créer une synergie qui dépasse les méthodes actuellement utilisées indépendamment par chaque communauté. Coût total programmé : 171 150,00 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2019Descriptif du projet
Le premier contexte est celui de modèles quantiques intégrables, où les propriétés de diffusion des ondes planes sont à l’origine des propriétés mathématiques puissantes, mais dont l’origine résiste parfois à une analyse rigoureuse. C’est particulièrement le cas dans le cadre des théories de champs quantiques, par exemple dans les dualités jauge-gravité.
Montant UE programmé : 94 132,50
Fin prévisionnelle d’opération : 30/09/2022
ISA – Méthodes mathématiques pour les systèmes physiques : Integrabilité, Scattering et Applications
Beaucoup de ces solutions sont développées en collaboration avec des partenaires industriels ou académiques: elles témoignent de notre implication dans le monde socio-économique.
Pour les solutions de mesures ou les systèmes d’acquisition (Instrumentation), notre stratégie en recherche vise à rester au plus proche des données de mesures pour produire des systèmes intégrés efficaces, c’est-à-dire performants avec le minimum de données.
Pour la gestion et le traitement des données, (systèmes intelligents (côté software)), l’objectif est d’intégrer la compréhension des données en les enrichissant sémantiquement pour améliorer et automatiser de manière pertinente leur usage.
Cette prise en compte de la sémantique peut se faire à différents niveaux (acquisition, traitement, analyse) et porter sur différents types de données (traditionnelles, multimédia, images, etc.)
Les retombées de ce projet vis à vis du grand public :
Réalisation d’un bâtiment intelligent (bâtiment I3Mà côté de l’ERIE) qui sera ouvert pour des visites grands publics et servira de living Lab.
Participation aux journées européennes de la Robotique (Site du Creusot ouvert à tout public)
Les outils développés seront également présentés lors des journées sciences en fêtes, journées portes ouvertes mais également dans le cadre de notre programme de diffusion scientifique avec l’espace Technovision sur le Creusot et les expositions Fourier sur Auxerre.
Positionnement du projet dans ce contexte, inclus les aspects innovants
Le projet étant de grande envergure, nous envisageons de :
- Développement, concrétisé par des prototypes, de nouvelles solutions d’acquisition répondant à des problématiques nouvelles ou nouvellement posées suite aux progrès en recherche et en technologie (comme par le passé, ces travaux conduiront à des dépôts de brevets)
- Mise au point de nouveaux algorithmes de traitement des données, en particulier en relation avec les données issues des nouveaux systèmes d’acquisition.
- Définition de nouveaux modèles et architectures pour la gestion autonome optimisée du réseau incluant les problématiques liées aux réseaux d’accès sans-fil et à l’informatique en nuage.
- Développement d’une Approche multi-modale de la reconstruction 3D et de l’analyse de scènes.
- Approche multi-robot collaborative
- Systèmes d’aides au diagnostiques, réadaptation en imagerie médicale et biomédicale
- Solutions logiciels et brevets pour les outils de recommandation de connaissance
- Exploiter la géométrie des formes de façon « intelligente », en exploitant le principe de la géométrie fractale, nous pouvons concevoir et contrôler des formes de type volumes poreux, structures arborescentes ou surfaces rugueuses.
- Création/soumission à l’Europe de deux masters joints (nouveau cadre ERASMUS +) , en imagerie médicale et en robotique autonome.
Secteur Scientifique : Photonique et matériaux avancés
Coordinateur scientifique : Fabrice MERIAUDEAU
Coordinateur adjoint : Dominique GINHAC
Laboratoires / équipes internes porteurs :
Laboratoire LE2I (département Vision, Electronique et Informatique), structuration autour des 4 axes du projet PARI « Instrumentation et systèmes intelligents »
Axe 1 : Développement de capteurs intelligents interconnectés (smart sensors / smart
cameras) – Porteur scientifique – Dr Julien Dubois (MCF HDR) – Université de Bourgogne – Dijon
Axe 2 : Systèmes de Perception Intelligents (vision active et robotique) – Dr Cédric Demonceaux (MCF HDR) – Université de Bourgogne – Le Creusot
Axe 3 : Systèmes sensibles au contexte (intelligence sémantique pour environnements intelligents) – Pr Christophe Nicolle – Université de Bourgogne – Dijon
Axe 4 : Mobilité numérique en réalité mixte (navigation / interactions naturelles) – Dr Jean-Rémy Chardonnet (MCF) – ENSAM Cluny
Axe Vulgarisation/diffusion scientifique : Pr Tadeuz Sliwa – Université de Bourgogne – Auxerre
Laboratoires / équipes internes partenaires :
La totalité du laboratoire Le2i
Instrumentation et Systèmes Intelligents
Le développement d’aliments innovants, qui soient à la fois savoureux, attractifs et sains pour le consommateur ainsi qu’adaptés à une production industrielle et à des contraintes environnementales de plus en plus grandes est un enjeu majeur pour les industries du secteur de l’alimentation. L’objectif étant de satisfaire les attentes des consommateurs en ce qui concerne la qualité sensorielle et nutritionnelle des aliments dans le cadre d’une alimentation durable constitue un enjeu majeur en termes d’innovation.
Instituts Carnot QUALIMENT – l’innovation en alimentation
Il propose une offre de compétences pluridisciplinaires qui permet de couvrir toutes les phases du Cycle de Vie d’un Produit (de la conception à la tenue en service, jusqu’à la fin de vie). Toute entreprise qui participe, quelle que soit sa taille, au cycle de vie de produits manufacturés mis sur le marché est concernée par l’offre de compétences en recherche technologique de l’iC ARTS. Son implantation multirégionale, proche des milieux socio-économiques, permet à l’iC ARTS une proximité avec les entreprises (en particulier PME) et les pôles de compétitivité qui développe des compétences et travaux de recherche technologique en sciences de l’ingénieur pour la conception de produits, les systèmes énergétiques et les interactions entre matériaux et procédés de fabrication.
Instituts Carnot ARTS – Actions de Recherche pour la Technologie et la Société
Le champ d’action de l’institut Carnot Cognition est multiple, touchant l’ensemble des secteurs de marché où les acteurs ont des produits et services comprenant une dimension humaine et sociale : transport, médias, télécommunications, santé, e-commerce, loisirs, assurance, sécurité, smart cities…
L’Institut Carnot COGNITION a pour objectifs de répondre aux attentes technologiques des industriels (grands groupes, PME-PMI) avec une culture de gestion de projet, de contribuer au développement de filières industrielles régionales par des efforts de structuration de la recherche et de l’ingénierie de projets de coopération et, de promouvoir une offre technologique globale, dans le cadre du développement de la cognition humaine et sociétale, auprès des acteurs du monde socio-économique.
Le projet Carnot Cognition a obtenu le label Tremplin Carnot en juillet 2016.
Institut Carnot Cognition – cognition, humain et société
Description du projet
Le numérique est placé au cœur de la stratégie de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche afin d’accompagner les usagers tant au niveau de la pédagogie, des activités de recherche qu’au niveau de l’administration.
La Direction du Numérique de l’université de Bourgogne travaille continuellement à la mise en place de services d’hébergement de données innovants pour répondre à ces besoins et enjeux socio-économiques. Ainsi, le Datacenter Régional UBFC a été mis en service en 2016, et labellisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2018.
La crise sanitaire du COVID-19 a initié un changement profond dans les usages du numérique, et accéléré la transition numérique dans tous les domaines d’activité des universités. Le Datacenter UBFC, centre névralgique pour l’hébergement des services et des données numériques, est au cœur de cette transformation.
Le projet INFRANUM s’inscrit pleinement dans ce contexte et vise à renforcer et moderniser les infrastructures numériques de l’université de Bourgogne selon 3 axes :
– Moderniser les infrastructures de cloud privé et de stockage de données et ainsi répondre aux besoins d’hébergement des acteurs locaux et nationaux tels que l’AMUE, ESUP
– Proposer à grande échelle l’enseignement à distance ou hybride par la mise en œuvre de salles pédagogiques virtualisées
– Augmenter la puissance de calcul numérique proposée par le mésocentre régional aux acteurs de la recherche
Coût total programmé : 2 997 618,17 €
Montant UE programmé : 2 997 618,17 €
Début prévisionnel d’opération : 01/09/2022
Fin prévisionnelle d’opération : 31/10/2023
INFRANUM : Extension des infrastructures numériques de l’université de Bourgogne pour la recherche, l’innovation et l’enseignement à distance
La Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) TRANSLAD (Médecine Translationnelle dans les maladies rares avec Anomalies du Développement) est un projet d’innovation génomique, original, novateur, d’envergure internationale et organisé au service des patients et de leurs familles. Individuellement rares, mais nombreuses (plus de 4000 maladies différentes) et collectivement fréquentes (1-3 % de la population), les maladies rares avec anomalies du développement constituent un enjeu majeur de santé publique. Le projet IMPADIAG 2020 a pour objectif de lutter contre l’impasse diagnostique par la cartographie optique de molécules d’ADN, afin d’identifier de nouvelles anomalies génétiques, et le développement d’études fonctionnelles ciblées dans des systèmes cellulaires et animaux, pour conclure quant à leur implication en pathologie humaine. La recherche sur les anomalies du développement nécessite ainsi une approche intégrée et multidisciplinaire. L’acquisition de nouvelles technologies innovantes, qui ne sont pas encore accessibles en France à la plupart des laboratoires de recherche, permettra à la FHU TRANSLAD de prendre une longueur d’avance sur la connaissance et la maitrise de ces approches au plan national et international. Stratégiquement, ces investissements permettront de confirmer sa place parmi les équipes de référence dans le domaine de la recherche génomique translationnelle dans les années à venir. Coût total programmé : 246 903,00 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2020Descriptif du projet
Montant UE programmé : 125 943,00
Fin prévisionnelle d’opération : 01/01/2023
IMPADIAG 2020 : résoudre l’IMPAsse DIAGnostique dans les maladies rares avec anomalies du développement en utilisant des approches intégrées
Porté par UBFC, le projet I-SITE BFC associe aux 6 membres fondateurs (université de Bourgogne, Université de Franche-Comté, Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, AgroSup Dijon, École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon, Groupe École Supérieure de Commerce de Dijon Bourgogne), l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers, les organismes de recherche (INRA, INSERM, CNRS, CEA) et les établissements hospitalo-universitaires de Bourgogne Franche-Comté : CHU Dijon, CHRU Besançon, Centre Georges-François Leclerc (CGFL), Etablissement Français du Sang (EFS). Il a été fortement soutenu par le monde socio-économique et l’ensemble des collectivités territoriales de Bourgogne Franche-Comté.
Voir aussi : Brochure I-Site Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC)
I-Site Bourgogne Franche-Comté
Les diamantoïdes des nanomatériaux promis à un avenir brillant. L’objectif de Jean-Cyrille Hierso est de les fonctionnaliser, c’est-à-dire de les modifier en les enrichissant avec des éléments chimiques autres que le carbone pour leur donner des nouvelles fonctions, et d’étudier les propriétés fondamentales inédites en découlant. Quelles en seront les applications pratiques ? : « Ce genre de matériaux à la structure carbonée si unique va forcément avoir une application, comme les nanotubes de carbone, … » dit-il. Jean-Cyrille Hierso pense – entre autres – à l’utilisation des nanodiamants pour améliorer le rendement de cellules solaires, ou encore pour la vectorisation de médicament par le transport d’un principe actif vers une zone ciblée du corps. Coût total programmé : 265 550,00 Début prévisionnel d’opération : 01/03/2017Descriptif du projet
Jean-Cyrille Hierso et son équipe valorisent les diamontoïdes. Ce sont des diamants infiniment petits (nanodiamants) très particuliers qui ont été découverts dans le pétrole il y a 80 ans. Ces espèces uniquement constituées de carbone et d’hydrogène, sont très stables chimiquement et compatibles avec le vivant. Leur potentiel d’application est très prometteur car ils constituent déjà une excellente base pour l’élaboration de nouveaux matériaux.
Montant UE programmé : 110 150,00
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2021
HYBRIDIAMS
Le projet Wine Cloud vise à développer la première plateforme d’analyse Big Data sur l’ensemble de la chaîne vitivinicole. Cette plateforme permettra de renforcer le lien entre les viticulteurs, les caves et les consommateurs en leur proposant une traçabilité complète du cycle de vie du vin, depuis la vigne jusqu’au consommateur. Coût total programmé : 306 637,93 Début prévisionnel d’opération : 01/06/2017Descriptif du projet
Montant UE programmé : 122 000,00
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2020
FUI 23 Wine Cloud
Le projet PARFAIT a pour objet le développement d’une plateforme sécurisée destinée à protéger les données personnelles contenues dans les applications gérant des objets connectés. Coût total programmé : 246 858,59 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2017Descriptif du projet
Montant UE programmé : 104 500,00
Fin prévisionnelle d’opération : 31/08/2020
FUI 23 – Programme PARFAIT
Les anomalies du développement (3% des naissances en France), comprenant malformations et des troubles des apprentissages, avec des risques de complications chroniques et sévères, handicap ou parfois risque vital, sont particulièrement ciblées.
C’est pour répondre à ces nouveaux enjeux que le projet TRANSLAD a été élaboré autour d’une équipe pluridisciplinaire, avec le principe que la recherche part du patient et les bénéfices de la recherche retournent au patient.
Autour de ce projet, une recherche neurocognitive et physiopathologique est mise en place, mais aussi un retour sur l’organisation des soins, plus efficace, et respectueuse des enjeux éthiques.
Axes du projet :
1. Identification de nouveaux gènes responsables d’AD et études physiopathologiques
2. Phénotypage fin des troubles neurocognitifs et réhabilitation des troubles cognitifs dans les pathologies génétiques développementales
3. Etude des enjeux éthiques, psychologiques et économiques du transfert des avancées de la recherche sur le SHD dans les soins
4. Transfert vers le patient et la famille
5. Recherche Clinique
6. Médiation sciences et société en génomique
Secteur scientifique : Santé et Ingénierie Moléculaire
Responsable du projet : Pr Laurence OLIVIER-FAIVRE
Laboratoires de l’uB porteur et partenaires
FHU Translad / Génétique des Anomalies du Développement / LEAD / EES – LEDi / LPPM
Partenaires financiers
Fonds PARI et Fonds européen de développement régional (FEDER)
FHU TRANSLAD : Innovation génomique et médecine translationnelle dans les anomalies du développement
F-CRIN propose de rassembler tous les acteurs institutionnels de la recherche clinique dans une gouvernance intégrée proposant des services coordonnés et un accès unique aux projets de recherche. Il propose également de créer un petit nombre d’unités d’essais cliniques de taille critique, capables de rivaliser dans la compétition internationale pour assurer la conception, la gestion et l’analyse des essais, de quelques centres professionnels de traitement de données, et de réseaux d’investigation capable de recruter rapidement un grand nombre de patients pour une pathologie donnée.
Porteur/Partenaires
Plateforme Nationale d’Infrastructures de Recherche Clinique (Besançon, Bordeaux, Brest, Cayenne, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Garches, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Saint-Pierre, Strasbourg, Toulouse, Tours, Villejuif)
F-CRIN – French Clinical Research Infrastructure Network
Résumé à venir
EXPERIM – Nuit des Chercheurs en France
Trois axes sont cruciaux pour permettre le développement d’un tel équipement
- Le développement technique du couplage TEP-IRM
- Le développement de sondes moléculaires et de nanomatériaux pouvant être détectés en TEP et en IRM
- Le développement de modèles animaux permettant de valider cet équipement
Porteur/Partenaires
Fondation de coopération scientifique Bourgogne Franche-Comté / GIE Pharmimage, Bioscan, Institut de chimie moléculaire de l’université de Bourgogne (ICMUB), Laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB- MaNaPI), Institut Univers transport interface nanostructure atmosphère et environnement molécule (UTINAM-NCM), pôle chimie moléculaire Welience (PCM), laboratoire électronique informatique et image (LE2I), CheMatech (PME), Oncodesign (PME), CHU de Digon, NVH-Medicinal (PME), Centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc (CGFL)
Equipement d’excellence (EQUIPEX) – IMAPPI : Integrated Magnetix resonance And Positron emission tomography in Preclinical Imaging
Au cours de la période périnatale, l’environnement nutritionnel joue un rôle clef dans la détermination des orientations métaboliques ultérieures de l’individu. Chez le rongeur, une suralimentation postnatale induit une augmentation du poids corporel, des altérations du métabolisme glucido-lipidique ainsi qu’une élévation de la pression artérielle, composantes caractéristiques du syndrome métabolique (ensemble de signes physiologiques qui accroissent les risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques et d’accident vasculaire cérébral (AVC)). Cette suralimentation postnatale conduit à : des changements précoces de l’expression génique cardiaque ; une altération progressive de la fonction contractile myocardique ; une augmentation de la sensibilité aux lésions d’ischémie-reperfusion ex vivo, qui peuvent être impliqués dans les pathologies cardio-métaboliques. Toutefois, ces pathologies surviennent à la maturité, touchant à la fois les femmes et les hommes, et les travaux expérimentaux portent essentiellement sur des rongeurs jeunes de sexe masculin. De plus, les mécanismes exacts de cette programmation, d’ordre probablement épigénétique, ne sont pas connus à ce jour. Ce travail précisera comment une programmation périnatale peut modifier l’expression génomique et prédisposer à un risque cardio-métabolique accru en vue de futures études chez l’homme et une meilleure prévention de ces risques. Coût total programmé : 33 340,00 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 18 337,00
Fin prévisionnelle d’opération : 30/09/2022
ENRIC
Plusieurs équipes du CSGA réunissent leurs compétences dans un projet pluridisciplinaire pour analyser les relations entre l’apport alimentaire maternel pendant la gestation et la lactation et le développement sensoriel précoce, la phénoménologie biologique de l’attractivité chimiosensorielle du lait dans ses fractions invariante et variable, cette dernière liée à l’alimentation maternelle, les effets à long terme de l’empreinte nutritionnelle maternelle sur les capacités métaboliques de la progéniture. D’une façon générale, ce projet vise à contribuer à la compréhension intégrée de l’ontogenèse de la sensorialité et de la régulation des mécanismes qui organisent la prise alimentaire, ainsi que leurs dérégulations par les nourritures et les styles de vie obésogènes. L’analyse chez l’animal vise in fine à comprendre les origines précoces du syndrome métabolique qui touche l’espèce humaine urbanisée. Coût total programmé : 161 600,00 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2020Descriptif du projet
Montant UE programmé : 88 385,00
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
EarlEAT : Impact de l’alimentation périnatale sur l’appétence du lait, le développement sensoriel et les performances métaboliques
E-RECOLNAT propose la valorisation de 350 ans de collections d’histoire naturelle.
Porteur/Partenaires
Muséum National d’Histoire naturelle (MNHN), Clermont-Ferrand, Dijon, Montpellier, Petit-Bourg
E-RECOLNAT
La détection et l’évaluation des dommages sur des matériaux composites biosourcés dus à des impacts est d’intérêt majeur pour le milieu industriel des transports et particulièrement pour l’aéronautique, le transport maritime et le secteur automobile. Anticiper ainsi la durée de vie des structures et envisager la meilleure réparation selon la topographie des dommages devient alors essentiel. De plus, afin de répondre aux nouvelles réglementations environnementales, constructeurs et équipementiers s’engagent à réduire l’empreinte carbone des véhicules. Dans ce but, de nouveaux matériaux légers à haute performance doivent être développés pour remplacer les matériaux métalliques classiques. Dans ce contexte, la recherche s’articule autour d’enjeux principaux : la réduction du poids et des émissions carbone des transports et l’amélioration constante des conditions de sécurité et de confort des passagers. Les matériaux composites, biosourcés apportent alors des solutions performantes et parfois multifonctionnelles. Cette étude se situe dans le cadre du développement de nouvelles méthodes d’évaluation de l’endommagement d’une structure composite biosourcée. Les endommagements seront caractérisés par trois techniques basées sur des analyses vibratoires, acoustiques et thermographiques. L’utilisation de la thermographie infrarouge comme outil de contrôle est aujourd’hui courante dans le domaine de l’industrie et de la recherche. Coût total programmé : 81 012,56 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 39 751,56
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
DELTA : Méthode prédictive de DEtection et Localisation d’endommagements structuraux de matériaux composites biosourcés par analyse ThermovibroAcoustique
Sans que l’on en ait conscience, de nombreuses applications technologiques d’usage quotidien font intervenir des systèmes quantiques. Un exemple est la résonance magnétique (IRM) utilisée en imagerie médicale. Un examen IRM est la répétition de quelques centaines à quelques milliers d’observations. L’amélioration du temps de transfert permettrait d’obtenir de meilleurs clichés en moins de temps, donc une meilleure utilisation du matériel permettant de traiter plus de patients, qui seraient exposés moins longtemps à des champs magnétiques intenses. Le projet CONSTAT vise à poser les bases sous-jacentes aux applications technologiques utilisées dans le cadre médical, et autres. Il est à l’interface de plusieurs disciplines : la recherche mathématique fondamentale avec un but applicatif en santé (imagerie, traitements), et multiples applications en la recherche photonique, nanosciences, modèles quantiques etc… L’étude de la modélisation des systèmes quantiques, algébriques et géométriques va permettre d’obtenir des encadrements analytiques et numériques du temps de contrôle minimal pour des systèmes bilinéaires invariants. Ce travail vise à identifier et contourner les difficultés de ces estimations numériques en grande dimension. Les bornes obtenues fourniront des indications sur le temps minimal nécessaire pour le transfert de populations dans un système quantique bilinéaire de dimension finie, et permettront d’améliorer les applications usuelles qui en découlent. Coût total programmé : 169 020,00 Début prévisionnel d’opération : 01/11/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 81 345,00
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
CONSTAT : Contrôle et statistiques, approche géométrique du contrôle, application au contrôle quantique et au traitement du signal
La pollution de l’air extérieur associée au changement du climat provoque plusieurs millions de décès par an. Les gaz produits par des processus de combustion et installations industrielles sont dangereux avec des valeur limites de l’ordre du ppm (part par million) en termes de niveau d’exposition. Le dioxyde d’azote NO2 joue un rôle dans les réactions atmosphériques à l’origine des pluies acides, il contribue à la formation du « smog » et à l’effet de serre. La détection et le contrôle des émissions de NO2 et d’oxyde de carbone CO sont essentiels pour réduire leurs effets dangereux sur l’environnement et l’humanité. Dans ce projet, l’étude des interactions chimiques à l’échelle moléculaire est appliquée pour le développement de dispositifs innovants. Elle se fonde sur l’interaction métal (complexes métalliques moléculaire, nanoparticules métalliques, surfaces métalliques réactives) et petites molécules réactives stratégiques (NO2, CO, H2, CO2, N2, NH3, etc.) soit en tant que source de matière et/ou d’énergie, soit comme polluant. Ce projet se base sur la catalyse métallique, issue de la maitrise de la chimie de coordination, et dont les principes généraux s’appliquent de manière transversale au domaine de la captation chimique et capteurs au sens large (détection, stockage, relargage, contrôle, quantification, dépollution). A termes, des dispositifs capteurs ultrasensibles visent à être proposés pour la détection et le contrôle de gaz toxiques tels que NO2 ou CO. Coût total programmé : 1 231 600,00 Début prévisionnel d’opération : 01/10/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 463 850,00
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
CoMICS – Chemistry of Molecular Interactions Catalysis & Sensors
Le cancer colorectal métastatique (mCRC) et le cancer gastrique metastatique (mGC) sont parmi les cancers les plus agressifs pour lesquels les stratégies thérapeutiques actuelles restent insuffisantes. L'administration de radiopharmaceutiques pour délivrer spécifiquement des isotopes radioactifs à une cible associée aux tumeurs, apparait comme une approche prometteuse combinant diagnostic et thérapie (théranostique) de ce type de cancer disséminé. Le projet COMETE vise à développer des molécules théranostiques par modification chimique de protéines capables de reconnaître spécifiquement des cibles tumorales, en leur greffant un agent chélatant de radionucléides à visée thérapeutique (radiothérapie interne vectorisée, RIV) et diagnostique (compagnon diagnostique). Notre projet s'articule autour de 4 objectifs : 1/ L'identification et la validation de cibles tumorales, 2/ le développement de nouvelles molécules de RIV pour traiter les mCRC et mGC, 3/ L'évaluation de l'efficacité antitumorale et de la toxicité des molécules de RIV suivant le radionucléide utilisé sur Coût total programmé : 2 198 504,03 Début prévisionnel d’opération : 01/06/2023Descriptif du projet
des modèles précliniques et 4/ Le développement d'agents d'imagerie compagnons pour sélectionner les patients répondeurs, déterminer la dose optimale, et suivre l'efficacité de la RIV. Ce projet ouvre la voie au développement de nouvelles approches de prise en charge personnalisée des patients afin d'améliorer l'efficacité des thérapies tout en limitant les effets secondaires potentiels.
Montant UE programmé : 1 954 804,03
Fin prévisionnelle d’opération : 01/06/2028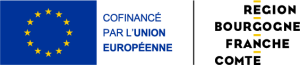
COMETE : moleCular radiOtherapy for METastatic Colorectal and gastric cancErs, (Radiothérapie interne vectorisée pour traiter le cancer colorectal métastatique (mCRC) et le cancer gastrique métastatique (mGC))
La stimulation cognitive et motrice est une thématique innovante, en pleine émergence à l’échelle internationale, qui repose sur une caractéristique essentielle du système nerveux central : sa plasticité neurale et fonctionnelle. Elle permet une intervention non médicamenteuse pour aider à la récupération de fonctions cognitives et motrices atteintes après lésion cérébrale. Ces approches doivent pouvoir être transposées au secteur éducatif pour améliorer les apprentissages. Si l’on trouve de très nombreux produits sur le marché censés « booster » notre cerveau, peu (sinon aucun) d’entre eux repose sur des bases scientifiques claires, et leur impact semble fort limité.
L’enjeu du projet est de créer de nouvelles industries liées à la stimulation cognitive et motrice en intégrant les technologies des sciences de l’information et de la communication, un champ en plein développement pour les populations vieillissantes dans nombre de pays européens, ainsi que dans le cadre scolaire aux Etats-Unis. L’interdisciplinarité des compétences mobilisées dans ce projet permettra de situer les chercheurs impliqués comme des partenaires indispensables pour l’innovation dans les secteurs biomédical, éducatif et du bien-être (le sport et l’industrie de la musique notamment). Les innovations qu’ils développeront dans les technologies liées à l’utilisation de la réalité virtuelle seront, par ailleurs, transférables à diverses applications.
Secteur scientifique : Apprentissage et santé (Care)
Responsable du projet : Romuald LEPERS (uB), Bénédicte POULIN-CHARRONNAT (INRA)
Laboratoires de l’uB porteur et partenaires
LEAD / CAPS / IREDU / Le2i
Partenaires financiers
Fonds PARI et Fonds européen de développement régional (FEDER)
COGSTIM – Stimulation cognitive, motrice, et réalité virtuelle : applications à la santé et à l’éducation
Le phénomène physico-chimique de « vieillissement atypique » des vins se caractérise par un vieillissement non maîtrisé et non voulu des vins. Il concerne tous les types de vins (blanc, rouge, Champagne…) et en particulier les vins blancs secs. Il se traduit par une oxydation prématurée (pertes d’arômes fruités et floraux, formation d’arômes non souhaités) et une hétérogénéité organoleptique lors de la dégustation de bouteilles de vin. La lutte contre ce phénomène est un enjeu important pour la filière viticole française qui représente un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros et plus de 600 000 emplois directs et indirects. Dans cette mesure, le projet Chardonnay+ propose une démarche innovante associant des approches scientifiques et techniques complémentaires (approches moléculaires ciblées et non ciblées, diagnostiques, sensorielles, modélisation…) afin d’identifier des composés clés permettant de prédire et/ou de limiter l’apparition des marqueurs du vieillissement atypique des vins blancs. Pour atteindre cet objectif, les partenaires vont développer et commercialiser des services à haute valeur ajoutée, notamment : Ce projet collaboratif public-privé réunit 2 partenaires du territoire : Coût total programmé : 339 364,17 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2017Descriptif projet
Montant UE programmé : 168 000,00
Fin prévisionnelle d’opération : 30/06/2021
Chardonnay +
Les grands défis sociétaux définis par la France et l’Europe à l’horizon 2020 reflètent ces préoccupations puisque 4 défis parmi les 9 proposés relèvent du développement durable. La recherche en chimie fondamentale, à l’échelle de l’atome et des molécules, en amont de ces préoccupations sociétales apparaît plus que jamais comme stratégique en termes de connaissances et force d’innovation et de proposition. Elle est au cœur de ces problématiques et s’impose comme un outil indispensable pour apporter des solutions pérennes à ces questions. Au-delà de la création de connaissances, l’objectif du projet est de faire bénéficier les entreprises partenaires du fruit de ces recherches pour leurs permettre d’améliorer leur outil de production et d’accroitre leur compétitivité. Dans le domaine de l’agroalimentaire, l’objectif est de répondre à des problématiques très concrètes de nos partenaires industriels sur l’emballage alimentaire et également sur la maturation des denrées. La création de la start-up SENSOLYS en région Bourgogne constitue un des enjeux du projet. Dans le domaine de l’énergie, une partie des travaux sera mené en partenariat avec une société leader du domaine et devrait contribuer également au développement de la start-up PorphyChem®. Dans le domaine des procédés propres la mise en place d’un partenariat en formation et en recherche avec la société pharmaceutique Inventiva est visée.
Positionnement du projet dans ce contexte, ses aspects innovants
Dans l’optique d’apporter des réponses pragmatiques aux grands défis sociétaux (préservation de l’environnement, transition écologique, raréfaction des ressources alimentaires, …), le projet CDEA vise à économiser les ressources naturelles, en valoriser d’autres encore inexploitées, améliorer les procédés de fabrication et contrôler la qualité des produits. Il bénéficie d’un contexte favorable en fédérant sur un seul site plus de 50 chercheurs statutaires de Bourgogne appartenant à 4 instituts du Grand Campus de Dijon dans les domaines de la chimie moléculaire, de l’agroalimentaire et de la toxicologie sous l’égide des 2 pôles de compétitivité VITAGORA et PNB. Un autre aspect de son originalité réside dans la mise en œuvre d’une chimie des métaux reconnue au niveau international depuis près de 50 ans pour apporter des solutions à des problématiques environnementales. Ces recherches sont effectuées dans un cadre inter-régional avec les laboratoires bisontins FEMTO-ST et UTINAM. Des compétences complémentaires sont apportées au travers de collaborations nationales et internationales dans le cadre de réseaux (ANR, NEEDS, COST, PHC) et du laboratoire international associé franco-russe LIA LAMREM hébergé à l’ICMUB.
Secteur Scientifique : Photonique et matériaux avancés
Coordinateur scientifique : Pierre Le Gendre
Coordinateur Adjoint : Jean-Pierre COUVERCELLE
Laboratoires internes porteurs :
– Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne (ICMUB)
Équipes internes porteurs
– ICMUB : OrganoMétallique et Catalyse pour une Chimie Bio- et éco-Compatible (OMBC3)
– PAM : Procédés Alimentaires et Physico-Chimie (PAPC)
– ICB : Nanostructures et Formulation (NANOFORM)
– DERTTECH Packtox : Département d’Etudes et de Transfert Technologique
Laboratoires partenaires :
– UMR Procédés Alimentaires et Microbiologiques (PAM-UMR AgroSup/uB)
– Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB)
– Laboratoire de toxicologie alimentaire DERTTECH « PACKTOX »
Équipes internes partenaires :
– ICMUB : Électrochimie, Matériaux Moléculaires, et Dispositifs (EMMD) ; Polyamines, Porphyrines, Développements et Applications (P2DA) ; Stéréochimie et Interactions Moléculaires (StereochIM).
– PAM : Procédés Alimentaires et Physico-Chimie (PAPC)
– ICB : Nanostructures et Formulation (NANOFORM)
– DERTTECH Packtox : Département d’Etudes et de Transfert Technologique
CDEA / Chimie Durable pour l’Environnement et l’Agroalimentaire
Dans un contexte politique et sociétal de réduction des intrants en viticulture et œnologie, le projet BIOVI propose des outils alternatifs aux intrants chimiques de la vigne et du vin, tout en respectant les critères de production et de qualité des produits. Ainsi, seront comparés les itinéraires de protection du vignoble en conventionnel et une stratégie intégrée utilisant des SDP (stimulations des défenses) contre le mildiou, l’oïdium et la pourriture grise. Cette comparaison portera entre autres sur la qualité sanitaire, l’efficacité des SDP à induire les défenses des vignes et enfin la compatibilité avec la bioprotection du vin. La bioprotection consiste à utiliser des microorganismes sélectionnés pour leur aptitude à entrer en compétition avec la flore naturelle parmi laquelle des microorganismes d’altérations. Seront étudiées l’efficacité et les conditions d’utilisation des levures non Saccharomyces comme outil de bioprotection pour réduire l’utilisation d’intrants et comprendre le fonctionnement de la bioprotection. Pour être une alternative aux sulfites, la bioprotection doit pouvoir remplacer tout ou une partie des propriétés des intrants, à savoir l’activité antioxydante, antioxydasique et antimicrobienne. L’activité antioxydante est particulièrement cruciale et l’expertise de notre équipe sera mise au service de l’identification, notamment par métabolomique, de marqueurs moléculaires impliqués dans l’activité antioxydante. Coût total programmé : 176 390,13 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 69 357,44
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
BIOVI : Réduction des intrants chimiques de la vigne au vin par le biocontrôle et la bioprotection
Il s’agit d’une infrastructure distribuée s’appuyant sur 64 biobanques et 6 collections microbiennes, avec une gouvernance intégrée, une coordination des services et un accès unique à l’échelon national, qui assure un couplage avec les réseaux Européens de biobanques.
Porteur/Partenaires
Infrastructure nationale de Biobanques (Amiens, Angers, Besançon, Bobigny, Bondy, Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Clichy, Créteil, Dijon, Évry, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Maisons-Alfort, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Saint-Étienne, Strasbourg, Thiverval-Grignon, Toulouse, Tours, Villejuif).
Biobanques
La prise en charge chirurgicale des anévrismes de l’aorte thoracique est basée sur le diamètre maximal de l’aorte. Cependant ce critère n’est pas robuste et il apparait nécessaire de le compléter avec d’autres paramètres qui prennent en compte la biomécanique de l’aorte. Le but de ce projet est la mise au point d’un modèle de l’aorte pathologique spécifique à chaque patient à partir d’IRM, et d’extraire des marqueurs biomécaniques prédictifs de rupture d’anévrisme. Ce modèle sera conçu à partir d’une population de 100 patients. Les marqueurs spécifiques de rupture d’anévrismes modélisés à partir de l’IRM pourront être une combinaison de l’élasticité, du strain, du stress pariétal ou de paramètres caractérisant le flux sanguin au sein de l’aorte tels que la vorticité et l’hélicité. Des études biomécaniques ex-vivo du tissu aortique prélevé lors de la chirurgie du patient, ainsi que des études histologiques de ces échantillons permettront de générer cette modélisation et de la valider. Les paramètres biomécaniques ex-vivo seront déduis notamment du module de Young et les études histologiques permettront d’avoir une idée précise de la composition du tissu aortique (notamment en collagène). L’objectif est de graduer l’état clinique du patient, de pouvoir détecter précocement des patients à risque de rupture d’anévrisme, même si leur diamètre de l’aorte n’a pas atteint la valeur seuil pour la chirurgie. Coût total programmé : 217 000€ Début prévisionnel d’opération : 01/07/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 117 000€
Fin prévisionnelle d’opération : 30/06/2023
BioAAT : Détermination de nouveaux paramètres Biomécaniques pour détecter précocement les patients à risque de rupture d’Anévrisme de l’Aorte Thoracique
Les activités humaines ont considérablement altéré les milieux naturels, ce qui soulève des questions telles que la pérennité des ressources biologiques ou l’impact des changements globaux sur les écosystèmes et la biodiversité.
En rassemblant les meilleures plateformes du domaine, AnaEE-France (Analyses et Expérimentations sur les Ecosystèmes – France) est la seule infrastructure nationale entièrement dédiée à l’étude des écosystèmes continentaux terrestres et aquatiques.
Porteur/Partenaires :
Station d’Ecologie Expérimentale du CNRS (Saint-Pierre-lès-Nemours, Dijon, Rennes, Montpellier, Nancy, Saint-Girons, Avignon, Grenoble, Thonon-les-Bains, Cayenne)
ANAEES – Analyses et Expérimentations sur les Ecosystèmes
Le projet ALIVE pluridisciplinaire et fédérateur, regroupe 3 équipes possédant des expertises reconnues en microbiologie/physicochimie du vin (UMR PAM), en microbiologie/biochimie du fromage (URTAL) et en sensorialité (CSGA). Il a pour objectif de répondre à un des enjeux majeurs des filières fromage et vin, ainsi qu’à une demande sociétale forte : la valorisation et la promotion de la biodiversité naturelle au sein de ces deux filières de production. Les objectifs principaux de ce projet sont d’étudier l’impact de l’utilisation de levains indigènes dans le process d’élaboration des fromages et des vins sur la qualité des produits, leur diversité sensorielle et d’étudier les facteurs biotiques et abiotiques permettant une maîtrise dans l’utilisation des levains indigènes. La caractérisation microbiologique et métabolique des produits fermentés permettra de déterminer la nature des consortia microbiens présents dans les levains et l’impact des conditions de préparation de ces levains sur la nature du microbiote. L’utilisation de ces levains pour l’élaboration des produits (vins, fromages) sera évaluée d’un point de vue microbiologique, d’un point de vue composition chimique (volatils et non-volatils) et d’un point de vue sensoriel en comparant ce produit à ceux issus d’itinéraires techniques mettant en oeuvre une microflore indigène sans sélection préalable ou une microflore exogène sélectionnée. Coût total programmé : 149 862,40 Début prévisionnel d’opération : 01/09/2020Descriptif du projet
Montant UE programmé : 82 424,32
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
ALIVE : impact quAlitatif des Levains Indigènes en Vin et fromagE
Les travaux menés dans le cadre du projet ALIM+ sont donc susceptibles d’améliorer la qualité de vie et la santé des consommateurs, par la réduction du nombre d’infections alimentaires, mais aussi par la production de probiotiques, de compléments alimentaires et d’aliments de meilleure qualité nutritionnelle et sensorielle.
Axes du projet :
1. Recherche fondamentale : Compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires permettant de contrôler la fonctionnalité et l’activité de macromolécules et de micro-organismes
2. Transfert : Produits et procédés innovants pour une alimentation sûre et durable
Secteur scientifique : Aliment et Environnement
Responsable du projet : Pr Patrick GERVAIS
Laboratoires de l’uB porteur et partenaires
PMB : Procédés Microbiologiques et Biotechnologiques / PAPC : Procédés Alimentaires et Physico-Chimie / VAlMiS : Vin-Aliments-Microbiologie-Stress / ICMUB (Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne).
Partenaires financiers
Fonds PARI et Fonds européen de développement régional (FEDER)
ALIM+
Il repose sur un changement de paradigme et une réconciliation de l’agriculture et de l’écologie. Des analyses sont nécessaires à différentes échelles spatiotemporelles pour comprendre et agir sur les composantes biotique et abiotique de l’environnement et leurs interactions.
L’ambition est :
- de progresser scientifiquement dans la compréhension du fonctionnement de l’environnement dans des situations d’anthropisation contrastées : situation sans anthropisation (environnement naturel, temps anciens), situation peu ou au contraire fortement anthropisée (agrosystèmes).
- de proposer des méthodes et stratégies de diagnostic environnemental et d’ingénierie écologique ainsi que des systèmes agricoles innovants.
De tels enjeux sont majeurs pour la région Bourgogne qui peut être qualifiée de territoire en mosaïque : mosaïque géologique, environnementale, climatique, hydrologique, pédologique, ou encore agronomique… Comprendre le fonctionnement des environnements est donc nécessaire dans le cadre d’un partenariat de transfert sur ces domaines auprès des acteurs du monde socio-économique aux niveaux local, national et international.
Dans ce contexte, les objectifs généraux sont la description et la compréhension des relations entre environnement abiotique qui se modifie et biodiversité (impact, adaptation, rétroaction) pour prédire l’impact du changement global.
Secteur scientifique : Aliment et environnement
Responsable du projet : Pascal NEIGE (uB) Philippe LEMANCEAU (INRA)
Laboratoires de l’uB porteur et partenaires
Agroécologie / Biogéosciences / Plateforme GISMO.
Partenaires financiers
Fonds PARI et Fonds européen de développement régional (FEDER)
AGREE – Fonctionnement des AGRosystèmes et des EnvironnEments naturels
Il vise également à concevoir de nouveaux lasers imaginés pour répondre à des applications spécifiques dans le domaine médical telles que le diagnostic de l’air expiré, la photothérapie ou bien l’aide à la cicatrisation, ainsi que dans le secteur industriel avec pour exemples le marquage, le micro-usinage et l’analyse des matériaux. PHOTCOM couvre la chaîne complète de la réalisation d’un système photonique, allant des sources lasers, aux puces optiques, aux systèmes fibrés et aux applications de haute technologie pour les communications, la santé et l’industrie. PHOTCOM s’appuie sur des collaborations industrielles régionales telles que URGO, TEB/Prynel, CEA, Photline.
Secteur Scientifique : Photonique et matériaux avancés
Coordinateur scientifique : Guy MILLOT
Coordinateurs adjoints : Gérard COLAS DES FRANCS – Olivier MUSSET
Laboratoires / équipes internes porteurs :
Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne (ICB), et Université de Bourgogne : Equipes SLCO, OSCN (partie Nano-optique), OCP et PFL
Laboratoires / équipes internes partenaires :
Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne (ICMUB), Laboratoire Electronique Informatique et Image (LE2I), Service de Neurologie du CHU, Laboratoire Biogéosciences
ACTION PHOTCOM / Photonique et Communications Optiques
Ce projet consiste à développer des lunettes électroniques servant de système sonore d’aide à la locomotion pédestre des déficients visuels. Ce système est basé sur une technologie qui convertit l’information visuo-spatiale en trois dimensions en un flux sonore spatialisé grâce à une méthode dite de substitution sensorielle. Cette technologie transmet l’information spatiale à l’utilisateur en s’appuyant sur l’audition binaurale, la spatialisation du son et une grammaire sonore artificielle. Ces travaux se réaliseront conjointement en Informatique et en Psychologie. La partie Informatique s’attachera à étudier les algorithmes permettant d’effectuer les traitements nécessaires sur support mobile. Le système matériel doit en effet valider 4 critères pour être opérationnel : ne pas être trop encombrant, ne pas trop chauffer, avoir une bonne autonomie énergétique et avoir une bonne réactivité. La partie Psychologie étudiera l’adéquation du signal sonore transmis avec les capacités humaines à interpréter des scènes sonores complexes pour en reconstruire des informations spatiales. Coût total programmé : 169 020,00 Début prévisionnel d’opération : 01/11/2019Descriptif du projet
Montant UE programmé : 81 345,00
Fin prévisionnelle d’opération : 31/12/2022
3D Sound Glasses
- kc_data:
- a:8:{i:0;s:0:"";s:4:"mode";s:2:"kc";s:3:"css";s:0:"";s:9:"max_width";s:0:"";s:7:"classes";s:0:"";s:9:"thumbnail";s:0:"";s:9:"collapsed";s:0:"";s:9:"optimized";s:0:"";}
- kc_raw_content:
- ao_post_optimize:
- a:5:{s:16:"ao_post_optimize";s:2:"on";s:19:"ao_post_js_optimize";s:2:"on";s:20:"ao_post_css_optimize";s:2:"on";s:12:"ao_post_ccss";s:2:"on";s:16:"ao_post_lazyload";s:2:"on";}
